L'irrésistible ascension des mormons américains
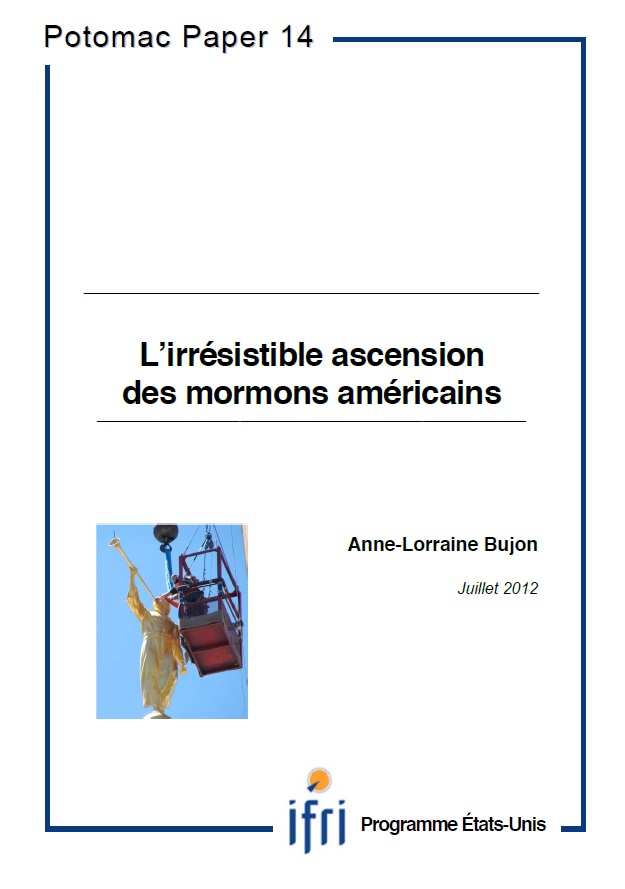
Les mormons, dont la candidature de Mitt Romney à la Maison-Blanche fait beaucoup parler, se réclament d'une religion née aux Etats-Unis au 19ème siècle. Les valeurs proposées par leur théologie forment un ensemble singulier et fort, sur lequel il est bon de revenir alors que la communauté, de plus en plus mainstream aux Etats-Unis, se développe à un rythme important dans le reste du monde.
Née aux États-Unis dans la première moitié du XIXe siècle, dans une époque d’effervescence religieuse, l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a été modelée par une histoire et une culture bien particulières.
Ses membres, d’abord en butte aux persécutions, puis à une traversée difficile du continent vers le Far West, ont entamé depuis la fin du XIXe siècle une « normalisation » qui connaît une étape supplémentaire avec la candidature de Mitt Romney à la présidence.
Le mormonisme reste pourtant difficile à appréhender. On ne peut en effet le réduire à un seul type de valeurs et de représentations. Typiquement américaine par certains aspects, sa théologie fait valoir le goût du défi, le sens de l’effort et l’esprit d’entreprise ; mais elle repose aussi sur le respect d’une hiérarchie puissante, un penchant au secret, qu’il s’agisse de liturgie ou des finances de l’Église, et un refus de la dissidence qui tranchent avec les habitudes tout aussi américaines de liberté individuelle et de débat public.
De même, les valeurs sociales que les mormons mettent en avant – importance de la famille, rôle bien délimité de la femme, rejet de l’homosexualité et, jusqu’en 1978, des Noirs dans l’Église – en font aujourd’hui des alliés objectifs des conservateurs. Mais l’intérêt constant pour le travail social et humanitaire les situerait plutôt dans le camp progressiste et leur soif de modernité, de science et de globalisation les positionne aux antipodes des créationnistes et autres chrétiens fondamentalistes, pour lequel la théologie mormone reste de toute manière inacceptable.
Si le particularisme des six millions de mormons aux États-Unis ne pose plus de problème aujourd’hui, leur Église fait face en revanche à un défi de grande ampleur : gérer son succès dans le reste du monde, où ses membres sont aujourd’hui 8 millions.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'irrésistible ascension des mormons américains
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLes migrations entre le Mexique et les États-Unis : "más de los mismo" ou fuite en avant ?
Alors que Trump s’apprête à renforcer les contrôles à la frontière avec le Mexique et expulser massivement les immigrés illégaux, le Mexique s’interroge sur les conséquences économiques de cette politique migratoire, et s’attend à devoir négocier cette question en lien avec les tarifs douaniers engagés par l’administration Trump.
Canada : le grand réveil ?
Le modèle économique canadien – voire le modèle canadien plus largement –, est traversé depuis sa création en 1867 de tensions inhérentes qui semblent avoir empêché, jusqu’à aujourd’hui, la réalisation de son plein potentiel. Chef du Service économique régional (SER) de l’ambassade de France à Ottawa, Morgan Larhant en dénombre cinq, liées aux matières premières, à la proximité des États-Unis, au manque d’intégration entre les 13 provinces et territoires, au fonctionnement du système fédéral, et à l’importance de l’immigration, comme source de son développement.
Donald Trump contre les États fédérés : le cas de New York
Si les politiques disruptives de l’administration Trump 2 se déploient au niveau fédéral et sur la scène internationale, elles se font également sentir dans les États fédérés et les grandes villes du pays. Au printemps 2025, plusieurs affaires concernant l’État et la ville de New York démontrent ainsi que les attaques du camp présidentiel contre la protection de l’environnement, la séparation des pouvoirs, la liberté d’expression, etc., sont également engagées au niveau local.
Les États-Unis de Trump, adversaires stratégiques et idéologiques de l’Europe
Le pire cauchemar sécuritaire des Européens semble se produire : mardi 18 février 2025, les ministres des affaires étrangères américain et russe Marco Rubio et Sergueï Lavrov se sont retrouvés en Arabie saoudite pour engager la normalisation des relations entre leurs deux pays. La réunion avait aussi pour objectif de mettre en place des négociations de paix pour l’Ukraine. Susceptibles d’affecter tout le vieux continent, les échanges se sont néanmoins déroulés sans les Européens ni les Ukrainiens.













