« Ankara est en train de devenir le vassal implicite de Moscou »

L’intervention militaire directe, depuis le 24 août, de la Turquie en Syrie marque-t-elle un tournant ?
C’est incontestablement un tournant pour la Turquie, mais il est encore trop tôt pour savoir si c’en est un dans la guerre en Syrie. Depuis l’instauration de la république sur les décombres de l’Empire ottoman après la première guerre mondiale, la culture de l’armée turque la porte à ne pas intervenir au-delà des frontières. Il y a eu quelques exceptions, comme la participation d’un contingent turc dans la guerre de Corée (1950-1953) ou l’invasion de Chypre en 1974. Des soldats turcs ont aussi participé à des opérations de maintien de la paix dans l’ex-Yougoslavie, en Somalie et en Afghanistan, mais il s’agissait de troupes non combattantes.
Depuis les années 1990, les forces armées ont surtout été utilisées sur le territoire national contre la guérilla kurde du PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan] et, dans ce cadre, elles ont mené plusieurs opérations transfrontalières dans le nord de l’Irak. Mais celles-ci ont toujours été ponctuelles et d’une ampleur limitée. La démonstration militaire des Turcs en Syrie est un aboutissement : la Turquie cherchait depuis une décennie à s’imposer au Moyen-Orient comme un soft power, et elle a compris, chemin faisant, que son statut de puissance dépend aussi de sa capacité de dissuasion et d’action militaire.
La multiplication des conflits armés depuis les « printemps arabes » [en 2011] rendait l’issue inéluctable : dès le début, Ankara a été interventionniste en Syrie, sans pour autant y envoyer ses troupes. Il a bâti une opposition syrienne dominée par les Frères musulmans et l’Armée syrienne libre (ASL). Puis il a été soupçonné d’aider des groupes islamistes plus ou moins radicaux et d’être peu regardant sur le passage des djihadistes par son territoire. Ce comportement a un peu changé, car les alliés occidentaux s’en sont alarmés. Il a maintenant franchi le pas de l’intervention armée.
Est-ce une preuve de force ou une fuite en avant du président turc, après le putsch raté de juillet ?
Cela pose d’abord la question de la capacité de la Turquie à mener une telle opération, alors même que son armée traverse une crise. Son fonctionnement est ébranlé par les purges dans la hiérarchie après la tentative de coup d’Etat. On peut aussi se demander si cette intervention s’insère dans une vision stratégique régionale plus globale. Depuis la démission en mai du premier ministre Ahmet Davutoglu, l’artisan de la grande politique étrangère de l’AKP [Parti de la justice et du développement, au pouvoir], on ne sait plus très bien ce que veut la diplomatie turque.
Ankara semble courir derrière les événements, tout en affirmant avoir préparé l’opération depuis deux ans. Les autorités avaient effectivement annoncé en février être prêtes à une intervention terrestre en accord avec les Saoudiens. Mais elles avaient vraisemblablement été rappelées à l’ordre par leurs alliés à l’époque. Aujourd’hui, la Turquie passe outre pour apparaître forte, alors qu’elle est en difficulté et que cela présente de réels risques. La Syrie s’est toujours montrée sourcilleuse en matière de souveraineté et du respect des frontières dans la région.
Jusqu’ici, la préoccupation principale d’Ankara comme de ses alliés était la vulnérabilité du territoire turc face à des attaques syriennes. Depuis 2011, chaque fois qu’il s’est produit des incidents à la frontière, les autorités turques se sont adressées à l’OTAN pour évoquer une possible activation de l’article 5 et de la clause de solidarité [si un pays de l’Alliance atlantique est attaqué, ses alliés doivent lui porter une aide militaire].
L’intervention armée est donc aussi une prise d’autonomie de la Turquie par rapport à l’OTAN, même si, d’une manière ou d’une autre, Ankara a négocié le feu vert américain. Les pays membres de l’Alliance ont toujours fait bloc pour affirmer leur solidarité avec la Turquie, quel que soit le cas de figure. Qu’en sera-t-il, maintenant qu’elle a projeté ses forces au-delà de la frontière, devenant un acteur militaire direct dans le conflit syrien ? Mais pour cette opération il fallait aussi l’aval de Moscou, qui contrôle le ciel syrien, notamment dans cette zone.
L’intervention turque vise l’organisation Etat islamique (EI), mais plus encore le PYD (Parti de l’union démocratique) kurde syrien, qui est pourtant soutenu par les alliés de la coalition. Comment réagissent ces derniers ?
Cette extension par la Turquie de ses opérations antikurdes à l’extérieur de son territoire met l’administration Obama face à ses contradictions. Frapper le PYD [le parti kurde syrien hégémonique] en Syrie revient-il à frapper le PKK en interne, même en considérant que ces deux organisations sont liées ? La guerre contre le PKK menée par Ankara en Turquie[depuis 1984] est considérée par ses alliés comme une opération de police visant une organisation classée terroriste par l’Union européenne et les Etats-Unis.
Bruxelles comme Washington ferment ainsi les yeux sur les pertes civiles très importantes, notamment à l’automne 2015, dans la répression des soulèvements à Diyarbakir, Cizre et dans d’autres villes du sud-est de la Turquie. Cette région est déjà entrée dans une logique de guerre.
Ankara martèle que le PYD syrien et le PKK turc sont une seule et même organisation, et assure par ailleurs que le parti prokurde légal [Parti démocratique des peuples, HDP] n’est rien d’autre qu’une vitrine du PKK. On a donc le sentiment que, pour les autorités, toute l’opposition kurde – légale ou non – est rassemblée sous le label « PKK », alors même que c’est une mosaïque de réalités et d’intérêts divers. Ankara n’a cependant pas réussi à convaincre de ses vues ses alliés traditionnels, comme les Etats-Unis et l’OTAN, ni ses nouveaux amis russes.
La politique syrienne d’Erdogan est-elle en train de changer ?
Il y a en effet un virage à 180 degrés, amorcé avant même la rencontre du 9 août à Saint-Pétersbourg, entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, même si les deux chefs d’Etat ne sont toujours pas d’accord sur le sort à réserver au président syrien Bachar Al-Assad. Longtemps, la Turquie a été perçue comme un acteur cohérent mais jusqu’au-boutiste, notamment pour son exigence d’un départ immédiat du dictateur syrien. Désormais, elle lâche du lest sur ce point, jusque-là central dans sa vision des choses, afin d’avoir l’aval russe pour son opération à la frontière considérée d’un intérêt sécuritaire majeur.
Poutine mène une stratégie régionale à plus long terme qu’Erdogan. Il a ainsi accepté la réconciliation, entérinée par une rencontre au sommet, après les excuses turques pour la destruction en novembre 2015 d’un avion Soukhoï par la chasse turque. Il accepte les initiatives turques en Syrie, car celles-ci ne le gênent pas fondamentalement. Il veut que les Turcs soient encore davantage ses débiteurs. Il garde la main sans s’impliquer, et pourra toujours leur demander des comptes plus tard.
En attendant, il leur permet de créer cette petite zone de sécurité au nord de la Syrie sur laquelle les Américains n’avaient jamais voulu s’engager. Je perçois une sorte de vassalisation implicite d’Ankara par rapport à la Russie, mais, pour la Turquie, il ne s’agit pas pour autant d’un renversement d’alliances.
La donne est-elle en train de changer pour les Kurdes en Syrie ?
Les Kurdes ont été utilisés par la coalition, et en premier lieu par les Américains, comme des auxiliaires militaires [contre l’EI], mais ils restent historiquement une variable d’ajustement. Les Occidentaux ont choisi de fermer les yeux sur l’agenda politique particulier des Kurdes syriens, car ils estiment que leur projet n’aboutira jamais. Personne ne croit à une sécession kurde en Turquie non plus. Le seul endroit où l’autonomie kurde fonctionne, c’est dans le nord de l’Irak, où, finalement, tout se passe plutôt bien.
Les Kurdes de Syrie sont aujourd’hui dans une situation difficile, d’autant que leur direction et celle du gouvernement régional du Kurdistan irakien sont à couteaux tirés. Ils ont mis la charrue avant les bœufs en tentant d’imposer un proto-Etat [le Rojava] qui a ouvert des bureaux « diplomatiques » dans différents pays, dont la France. C’est un acteurtrop nouveau pour avoir des relais solides, et qui ne dispose pas d’une réelle base de légitimité hors de sa région. Même si, au nom de l’urgence nationale, il s’est imposé face aux autres partis kurdes syriens comme unique force représentative.
A partir du moment où il s’est renforcé, comme c’est le cas depuis un an, il est entré presque mécaniquement en conflit avec les autres acteurs, y compris ceux avec qui il avait de bons rapports, comme le régime syrien. Ce dernier avait toujours eu une attitude ambiguë à leur égard mais, maintenant, il est prêt à se battre contre le PYD. Les relations de ce dernier avec l’opposition syrienne ont par ailleurs toujours été très mauvaises.
Les Kurdes syriens risquent-ils d’être lâchés par leurs alliés ?
En 2015, le PYD avait réussi ce tour de force d’être soutenu à la fois par Washington et par Moscou. Dans la guerre des images, face aux vidéos sordides des exactions de l’EI, les combattants – et surtout les combattantes – kurdes syriens sont devenus des symboles d’héroïsme et de résistance.
La réalité de la guerre syrienne est beaucoup plus complexe et pas du tout romantique. Et ses enjeux internationaux vont bien au-delà de la question de l’avenir des Kurdes. Pour l’Union européenne, par exemple, la priorité est de bloquer l’afflux des réfugiés. Les Américains, eux, voient que l’EI est en recul.
Le rôle des Kurdes syriens est donc moins important, alors même que leur montée en puissancepose problème à l’allié turc. L’Iran lui-même s’inquiète de cette montée en puissance du PYD, d’autant qu’il doit gérer sa propre rébellion kurde menée par le PJAK [Parti pour une vie libre au Kurdistan], parti frère du PYD syrien et du PKK turc. En définitive, le PYD, qui tenait le haut de l’affiche sans avoir d’alliés solides, risque bien d’en faire les frais.
Interview parue dans Le Monde

Média
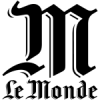
Partager








