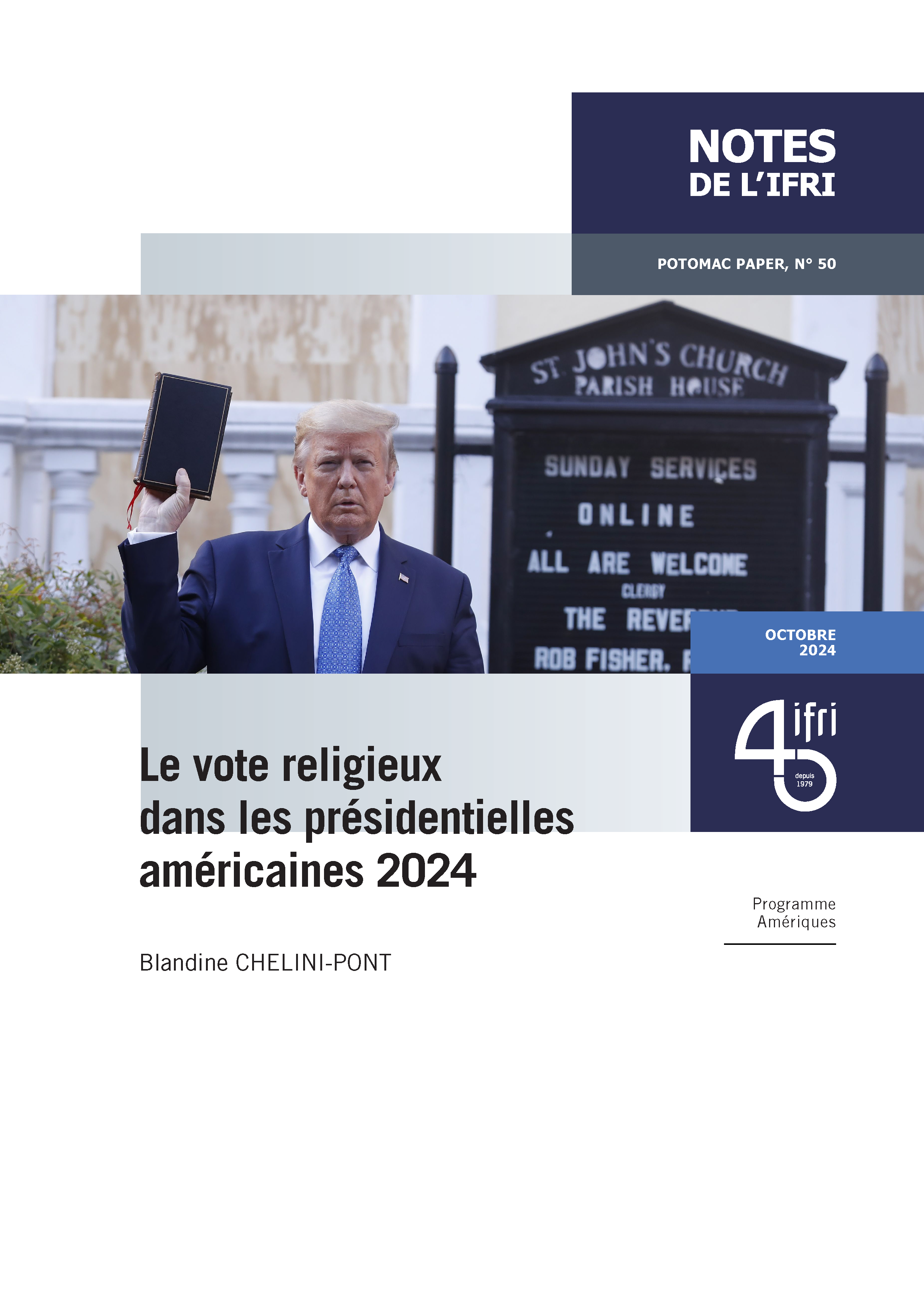Rohingya : « Aung San Suu Kyi agit par petits pas conciliants parce qu’elle ne peut pas faire autrement »

Que vous inspirent les déclarations de la dirigeante birmane sur les Rohingya, qui a condamné « les violations des droits de l’homme » dont ils sont victimes et a déclaré que son pays était « prêt » à organiser le retour des Rohingya réfugiés au Bangladesh ?
Sophie Boisseau du Rocher : Les déclarations d’Aung San Suu Kyi pourraient décevoir ceux qui attendaient un revirement complet et public de ses positions, qui espéraient par exemple qu’elle condamne publiquement l’armée pour les exactions commises dans l’Etat d’Arakan, exactions qui pourraient même paraître sous-estimées. Il s’agit, à mon avis, d’une erreur de jugement et d’une méconnaissance de la situation sur place.
Quand Mme Aung San Suu Kyi évoque « les souffrances de notre peuple » et l’appartenance à une nation complexe, elle fait un geste très sensible à l’égard de la communauté musulmane, qu’implicitement elle intègre à la nation, alors que certains sur place refusent cette appartenance. Ce geste s’inscrit par ailleurs dans le prolongement de celui, passé inaperçu en 2016, du changement d’appellation de Bengali (le terme de « Rohingya » n’est pas utilisé en Birmanie) pour celle de « communauté musulmane de l’Arakan ». Etre reconnue comme communauté de l’Arakan est déterminant, puisque l’Arakan (Etat Rakhine) est un Etat de la Birmanie ; première étape, en pointillé, dans un long processus de reconnaissance.
Sur le fond, la conseillère d’Etat a fait preuve d’un vrai courage en annonçant devant le Parlement et quelques diplomates étrangers qu’elle souhaitait une redéfinition des paramètres historiques de la construction nationale. Et cette déclaration m’inspire à la fois de l’admiration (aucune personnalité politique n’avait jusqu’ici eu le courage d’aborder la question en ces termes) et un vrai doute : comment va-t-elle procéder dans un contexte aussi sensible ?
Cette déclaration s’inscrit aussi dans la suite logique de sa ligne de conduite à l’égard de la question musulmane depuis sa prise de fonctions : reposer les fondements de la construction nationale en Birmanie en y intégrant cette communauté musulmane de l’Arakan. La question de la réconciliation nationale est centrale : elle est une urgence politique et sociétale et elle s’inscrit dans le prolongement de l’action engagée par son père à Panglong en 1947. Dans son esprit, cet objectif passera, et elle a raison, par des compromis politiques.
Aung San Suu Kyi a été critiquée pour son silence dans ce dossier. Pour autant, ces récentes déclarations rompent-elles avec ce qu’elle a pu faire jusqu’à présent ?
Il y a ici deux éléments distincts. D’une part, son silence à l’égard des exactions et persécutions (identifiées assez précisément par des ONG comme Human Rights Watch) est difficilement compréhensible, parce que c’est la dignité humaine qui est atteinte, qui touche des innocents et qui mérite, au minimum, de la compassion. Mais jamais dans l’histoire récente les musulmans d’Arakan n’ont suscité la moindre compassion en Birmanie. D’autre part, il y a son silence à l’égard des exactions perpétrées par l’armée, qui relève plus de la tactique politique.
Il me semble que les médias occidentaux, et certaines personnalités contentes de se faire valoir, ont fait une erreur d’interprétation en affirmant que son silence était un soutien, un blanc-seing, à l’armée. Ceux-là ne connaissent pas la situation sur place et la faible marge de manœuvre dont dispose la conseillère d’Etat et ministre des affaires étrangères : le moindre dérapage et c’est l’ensemble des processus (à la fois de réconciliation nationale et de transition démocratique) qui se grippe.
-
Elle n’est ni naïve ni cynique : elle s’interroge sur la façon d’optimiser le succès du processus de réconciliation
Elle n’est ni naïve ni cynique : elle a les poings liés par des mécanismes verrouillés par les militaires qui ont rédigé la Constitution en 2008. Dans ces conditions, elle s’interroge sur la façon d’optimiser le succès de ce processus de réconciliation nationale. Affronter directement l’armée par des propos critiques, immédiatement relayés par les médias occidentaux, lui paraît contre-productif. D’ailleurs, dans son discours du 19 septembre, elle s’en est tenue à des positions de principe pour « condamner toutes les violations des droits de l’homme », sans désigner tel ou tel régiment.
L’assentiment de l’armée tout au long de ce processus lui est nécessaire car, et on vient de le voir à nouveau avec ces tragiques événements, la Tatmadaw (les forces armées birmanes) a les moyens d’exacerber en quelques jours une situation que l’histoire, les malentendus, les ressentiments ont rendue hypersensible. On peut être d’accord ou pas avec son analyse et sa tactique, mais l’accabler comme certains l’ont fait en souhaitant lui retirer son prix Nobel manque de réalisme. La politique de l’indignation lui paraît immature et improductive en comparaison de cet objectif à long terme.
Sur le fond, ce qu’elle dit, c’est qu’il n’y aura pas de règlement du sort des musulmans sans repenser les conditions d’accès à la nationalité birmane. Et cette question dépasse les événements en cours ; elle s’inscrit dans un projet national extrêmement complexe et chaotique.
Face à l’étendue de la catastrophe humanitaire, avec 400 000 réfugiés, peut-on faire l’économie d’une franche condamnation des responsables, c’est-à-dire l’armée ?
Personne n’est dupe : l’armée commet depuis des années des persécutions à l’égard de cette communauté, plus ou moins graves, plus ou moins visibles. L’armée, fondée par son père, le général Aung San, a été, et reste encore, dans une moindre mesure, le pilier de cet Etat qui a tant de difficulté à se construire comme nation. Elle reste un acteur politique déterminant. La Constitution de 2008 lui donne des pouvoirs de blocage (notamment un droit de veto sur tout amendement) qui limite considérablement la marge de manœuvre d’Aung San Suu Kyi.
-
Aung San Suu Kyi a jugé qu’il valait mieux (…) modifier progressivement les paramètres
La Tatmadaw n’a accepté la transition que parce qu’elle la contrôlait et parce qu’elle lui permettait de garder, en les transformant, certes, ses intérêts. Il n’était aucunement question de conviction démocratique dans ce changement. Aung San Suu Kyi a jugé qu’il valait mieux saisir cette opportunité et tenter, une fois qu’elle serait légitime dans l’échiquier politique, de modifier progressivement les paramètres. C’est le même calcul qu’elle fait aujourd’hui. Elle n’est pas dans l’émotion, et par calcul, et par tempérament.
Un autre paramètre entre en ligne de compte, dont on parle assez peu : l’Arakan recèle des matières premières importantes, notamment des gisements de gaz offshore, et d’une position stratégique à l’entrée du golfe du Bengale, qui intéresse les Chinois pour la mise en œuvre des routes de la soie. Ceux-ci ont même prévu d’installer une zone économique spéciale autour du port en eaux profondes de Kyaukphyu, où déjà un gazoduc et un oléoduc leur permettent d’éviter le passage par le détroit de Malacca. Les projets d’Aung San Suu Kyi « en faveur de la paix et de la stabilité » (les Chinois sont les seuls, avec les Indiens, à avoir apporté leur soutien à la conseillère d’Etat) leur conviennent jusqu’à un certain point, puisqu’ils ne veulent pas d’une démocratie qui pourrait mettre à mal leurs intérêts.
Peut-on croire que l’armée serait prête à l’assister pour organiser le rapatriement des réfugiés ?
A nouveau, le pari d’Aung San Suu Kyi, c’est d’associer l’armée à ce processus ; de lui montrer qu’elle a plus à gagner à le voir réussir qu’à un échec annoncé, voire préparé. Les condamnations de la communauté internationale ne gênent pas les militaires qui les affrontent depuis des décennies ; leurs intérêts, en revanche, constituent des arguments plus concrets.
-
Le chef d’Etat major, Min Aung Halaing, décide seul des représailles « au nom de la sécurité »
La situation ne va pas changer en quelques mois ou années, quand elle dure depuis si longtemps : depuis son indépendance, en 1948, la Birmanie n’a jamais connu un état de paix nationale. De nombreuses ethnies (Shin, Kachin…) restent aujourd’hui en conflit avec le gouvernement central, et le chef d’Etat major, Min Aung Halaing, décide seul des représailles « au nom de la sécurité ». Il peut en quelques secondes ruiner les laborieux efforts engagés par le gouvernement ou imposer les termes de la négociation.
Ce sera un processus long et tortueux, mais Aung San Suu Kyi a rappelé ce matin aux Birmans et au monde que le pays ne pourra en faire l’économie. On se souviendra que le président Thein Sein (2011-2016), pourtant ancien général et proche du commandement de la Tatmadaw, n’avait pas réussi sa conférence de réconciliation nationale en dépit d’un engagement volontaire mené dès 2011. Il s’agit d’abord d’une question politique.
Sur le plan historique, qu’est-ce qui explique selon vous ces tensions ?
L’héritage colonial britannique a une grande part de responsabilité dans la situation des musulmans de l’Arakan. Car leur nombre a bondi pendant cette période (1826-1947), et s’ils ont été utilisés par la puissance impériale pour valoriser le territoire et ses ressources, Londres les a laissés seuls face au ressentiment birman au moment de l’indépendance (et aux exactions japonaises pendant le second conflit mondial).
D’ethnie différente que les Bamars (les Birmans), de religion différente, et surtout associés à l’impérialisme britannique, les musulmans de l’Arakan n’ont pas pu défendre leurs droits. L’arrivée du général Ne Win au pouvoir, en 1962, et les sombres années qui ont suivi ont ruiné tout espoir d’intégration. L’armée s’est ensuite rapprochée des nationalistes bouddhistes et a rendu la situation encore plus difficile pour cette communauté.
Quand on revient au discours d’Aung San Suu Kyi du 19 septembre, on prend la mesure de l’ambition de son projet : « Nous ne voulons pas voir la Birmanie divisée par les croyances religieuses, l’appartenance à une ethnie ou la politique. » Ce qu’elle dit est complètement « révolutionnaire » dans le contexte historique de la Birmanie. Et pourrait déboucher sur des formes politiques nouvelles (la question du fédéralisme) qu’elle voudrait discuter. C’est un pari risqué, mais nécessaire à une stabilité durable. Il mérite toute notre attention.
Voir l'interview sur Lemonde.fr

Média

Partager