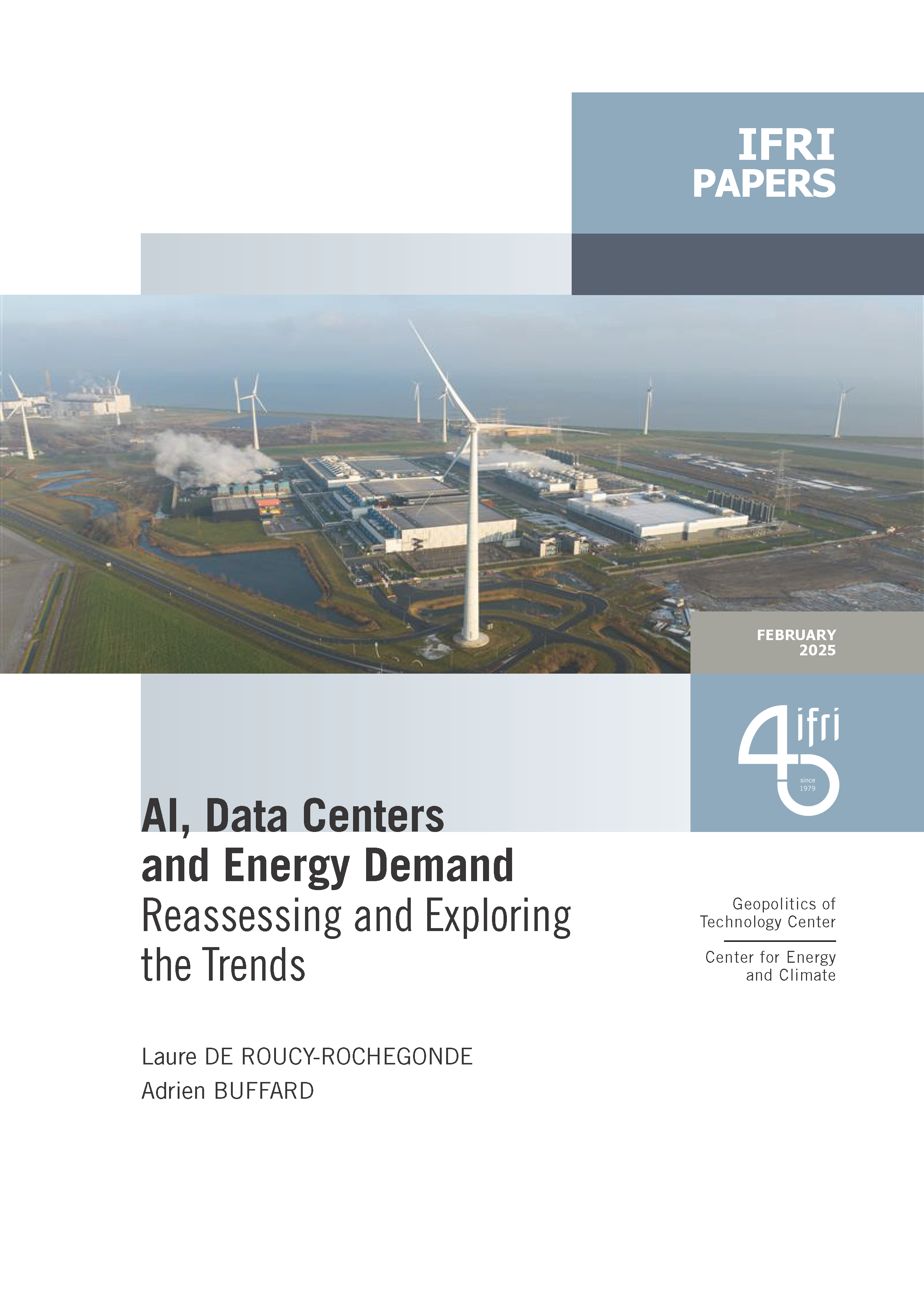Kennedy's War: Berlin, Cuba, Laos and Vietnam
(This book's review is published in French only.)
On compte déjà plus de livres sur John Fitzgerald Kennedy que de jours à sa présidence. Si les aspects privés du personnage ont alimenté les travaux les plus récents, comme ses liaisons extraconjugales ou son état de santé, le dernier ouvrage de Lawrence Freedman constitue une synthèse particulièrement bienvenue sur la politique étrangère de l’ancien président des Etats-Unis. Avec la minutie et la rigueur qui caractérisent invariablement les travaux de Lawrence Freedman, celui-ci retrace les épisodes les plus significatifs de la confrontation Est-Ouest, comme la confrontation sur Berlin et la crise de Cuba, et les étapes de l’implication des Etats-Unis au Laos et au Vietnam.
Mais Kennedy’s Wars n’est pas seulement un livre d’histoire; c’est aussi et surtout une reconstitution détaillée, au sens de R. Collingwood, et une interprétation intelligible, pour reprendre l’adjectif de R. Aron, de la prise de décision de l’Administration Kennedy. Pour Freedman, le point commun entre les différentes crises qui ont jalonné la présidence Kennedy réside dans la flexibilité, la maîtrise et la prudence dont a fait preuve le président. Celui-ci s’est constamment efforcé de privilégier le moindre risque et de rechercher l’avis du plus grand nombre, tout en préservant à la fois la crédibilité de la position des Etats-Unis, mais aussi le statut de son adversaire soviétique. Dans le climat d’affrontement qui caractérisait les rapports Est-Ouest aux débuts des années 1960, Kennedy estimait que son premier devoir de chef d’Etat était d’éviter l’irréparable d’une guerre nucléaire. Ce principe de précaution devait guider les impulsions majeures de sa présidence. Vis-à-vis de la doctrine nucléaire, tout l’exercice de la riposte flexible avait pour but d’éviter le manichéisme de la reddition ou de l’anéantissement. Le président fut l’un des premiers à utiliser les notions d’escalade contrôlée et de guerre limitée qui avaient animé les travaux de H. Kissinger, H. Kahn ou W. Kaufmann à la fin des années 1950.
Cette volonté affichée de créer une marge de manœuvre supplémentaire, de redonner à la diplomatie un espace suffisant, fut d’abord mise à l’épreuve lors des tensions successives à propos de Berlin, et surtout lors de la crise de Cuba. Plus de 40 ans après les faits, on éprouve encore quelques difficultés à saisir l’intensité de cet affrontement. On sait maintenant que les risques de guerre furent bien plus élevés que ne le suggéra l’historiographie de la crise jusqu’à une période récente. Eviter un nouvel août 1914 en préservant des options subsidiaires, dissiper les malentendus en maintenant le dialogue, se fixer une limite à ne pas franchir tout en ménageant des portes de sorties honorables à son adversaire, choisir l’alternative la moins risquée au risque de contredire ses collaborateurs, tels furent les choix du président. Après le succès de Cuba, l’idée d’un ferme contrôle politique sur les militaires et d’une microgestion progressive des conflits devint d’autant plus convaincante aux yeux de l’Administration Kennedy. La tragédie fit que ce succès dans les Caraïbes devint un cauchemar au Vietnam. Mais, dans ce domaine, l’indécision de Lyndon Johnson tint un rôle majeur. Freedman montre à juste titre les ambivalences du président au Laos d’abord, au Vietnam ensuite.
En nos temps de doctrine de guerre préemptive, de terrorisme international et d’unilatéralisme à Washington, cette analyse prend une dimension nouvelle. Le président George W. Bush et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld semblent sur bien des points à l’opposé des convictions de Kennedy. Certes, le 11 septembre explique bien des choses; mais l’aveuglement de la puissance ne justifie pas le rejet des préceptes élémentaires de la prudence. A tous les partisans inconditionnels d’une attaque préemptive sur l’Irak, on ne peut que conseiller la lecture de ce livre.