La politique étrangère de l’Allemagne : une transformation inachevée
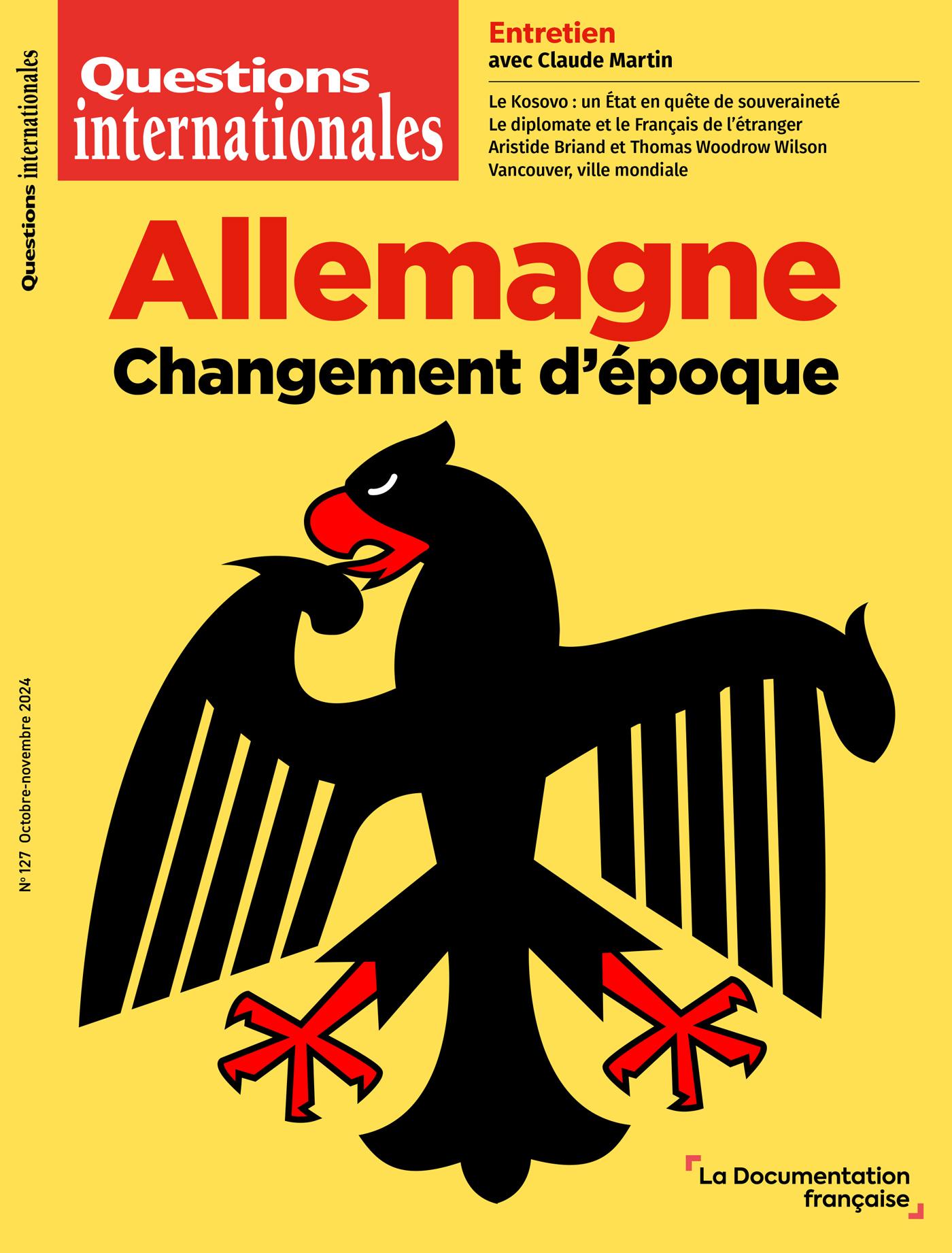
Dans un discours du 27 février 2022 devant le Bundestag, le chancelier Olaf Scholz a qualifié la rupture provoquée par l'intervention russe en Ukraine de « changement d'époque » (Zeitenwende). Ces mots puissant marquent la fin de la retenue et d'une certaine forme de naïveté allemande. Tiraillé entre la nécessité de conserver les bonnes grâces de l'allié américain et celle de ménager le partenaire commercial chinois, Berlin est mis face à ses propres contradictions.

Qualifiant de « changement d'époque » (Zeitenwende) la césure que l'agression russe contre l'Ukraine impose à l'ordre international depuis le 24 février 2022, le chancelier fédéral Olaf Scholz a trouvé le mot juste. Il a également admis que la politique étrangère de l'Allemagne entrait dans une phase radicalement nouvelle, laissant derrière elle une période « heureuse » de trois décennies pendant laquelle le pays a su, de point de vue politique et économique, pleinement tirer parti de l'ouverture des frontières et de la globalisation. Profitant du grand marché intérieur de l'Union européenne, d'importations d'hydrocarbures à faible coût venant de Russie et d'un marché chinois en pleine expansion, de sa proximité géographique avec l'Europe du Centre-Est, l'Allemagne s'est muée en un soft power influent et incontournable.
- Hans Stark est professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'Institut français des relations internationales (Ifri).
Cet article est paru dans la revue Questions internationales, n° 127 octobre-novembre 2024, intitulé « Allemagne - Changement d'époque », (pages 73 à 82).
>> >> Lire la publication de Hans Stark :
"Changement d'époque (Zeitenwende) : qu'est-ce que l’agression russe de l’Ukraine fait à l’Allemagne ?" paru dans la revue Allemagne d'aujourd'hui, n° 243, janvier-mars 2023 et co-dirigé par Hans Stark et Jérôme Vaillant.
Texte citation
L'Allemagne a accepté pendant de longues années une double dépendance énergétique et commerciale envers deux pays qui constituent désormais une menace clairement établie pour l'ordre international : la Russie et la Chine.

Conseiller pour les relations franco-allemandes à l'Ifri

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
DOI
La Documentation française
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.













