The Wider Context: Germany's Baltic Engagement, the 'Munich Consensus' and the Future of European Security
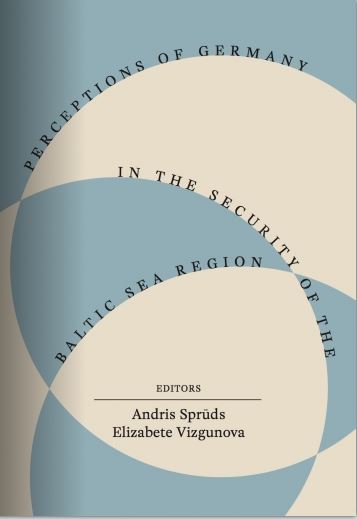
De par sa taille et son poids économique et politique en Europe, l’Allemagne est un acteur important dans la région de la mer Baltique (BSR). Berlin a choisi de jouer un rôle actif : la présence de la Bundeswehr en Lituanie dans le cadre de la stratégie de l’OTAN de l’eFP - présence avancée renforcée - mais aussi des propositions relatives aux pays baltes concernant la coopération de la mer Baltique (Baltic Sea Cooperation) au sein du « Conseil des États de la mer Baltique » (CBBS), dont l’Allemagne est un membre fondateur, sont des exemples d’engagement allemand dans la région. Au-delà de la dimension régionale, l’engagement de l’Allemagne dans le BSR doit être considéré dans le contexte plus large de la politique étrangère, de sécurité et de défense allemande.
Dans ce contexte plus large, 2014 est une année charnière - avec un double sens. Les conclusions tirées de l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en mars de cette année-là ont conduit à un changement de paradigme dans les approches allemandes vis-à-vis de Moscou. Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité plus tôt dans la même année, de hauts responsables ont exposé ce qui a parfois été qualifié de « consensus de Munich »: l'Allemagne assumerait davantage de responsabilité en matière de sécurité et de stabilité internationales. Depuis, les discours et les politiques allemandes ont considérablement évolués : la nouvelle approche devait se traduire par un engagement réel sur la scène internationale. Ceci était (et continue d'être) accompagné de mesures au niveau national. L’Allemagne a décidé d’augmenter son budget de défense. En outre, un nouveau « Livre blanc sur la sécurité et la défense et l’avenir de la Bundeswehr » a remplacé son prédécesseur, vieux de dix ans et dépassé, en juillet 2016.
Dans ce contexte, l’engagement de l’Allemagne dans le BSR peut être un test pour l’évolution générale de la politique de sécurité allemande. Ce chapitre analysera en conséquence comment la démarche de Berlin dans la région de mer Baltique s’inscrit dans le contexte plus large de la politique de sécurité et de défense allemande en vigueur. Quels sont les facteurs décisifs probables de l’engagement de l’Allemagne dans la région ? ; Berlin entend-elle jouer le rôle de « puissance baltique », et comment son approche est-elle liée au contexte plus large de la politique étrangère et de sécurité allemande ?
A propos du livre
Le projet de ce livre "Perceptions of Germany in the Security on the Baltic Sea Region" rassemble les contributions de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, du Danemark, de la Pologne, de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie et de l'Allemagne. Il analyse les perceptions de la contribution de l'Allemagne à la « hard, soft and regional security » de la région de la mer Baltique. La publication se livre également à un exercice de cartographie, identifiant les plus importants facteurs de perception - diverses parties prenantes des secteurs public et privé et les principaux récits de sécurité - et propose des recommandations.
A propos de l'auteur
Barbara Kunz est chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri). Elle se spécialise dans les affaires de sécurité euro-atlantiques avec un accent particulier sur la coopération franco-allemande en matière de sécurité et de défense et sur les dynamiques de sécurité dans la région de la mer Baltique. Barbara Kunz est titulaire d'un doctorat de l'Université de Stockholm et est diplômé de Sciences Po, Paris.
Ce livre est publié en anglais par le Latvian Institute of International Affairs en collaboration avec la Konrad Adenauer Stiftung. Il est disponible ici: Perceptions of Germany in the Security on the Baltic Sea Region.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesPerspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine
Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.
La brigade franco-allemande et la relance de la défense européenne
Une chose est claire depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : le projet d’unification européenne est menacé dans son existence même. À moins d’élaborer une politique de défense souveraine pour parer à la guerre en Ukraine et à l’affaiblissement des garanties de sécurité américaines, l’Union européenne verra se poursuivre l’érosion de sa dynamique de cohésion interne et de son attractivité externe.
Friedrich Merz et la Zeitenwende 2.0. Une « nouvelle ère » pour les relations transatlantiques ?
Le 23 février 2025, près de 60 millions d’électeurs ont été appelés à élire un nouveau Bundestag. Ces élections donneront également naissance à un nouveau gouvernement dans la première économie d’Europe.
Après les élections : l’Allemagne en quête d’une stabilité ébranlée ?
Avec 82,5 % de participation, l’Allemagne a enregistré un taux de mobilisation inédit depuis 1987, une hausse de 6,1 points par rapport à 2021. Comme en 2021, cette forte participation a profité à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a su mobiliser un grand nombre d’anciens abstentionnistes.













